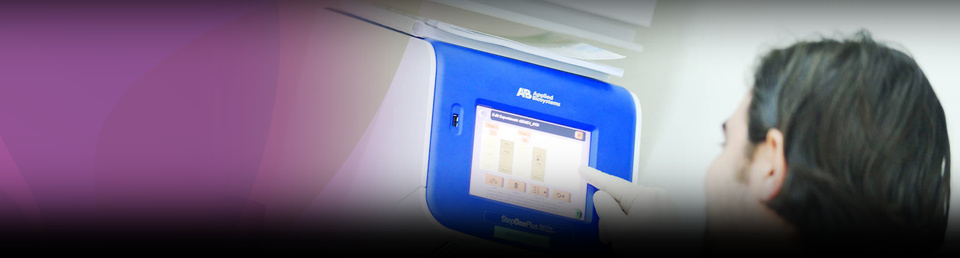Jean-François Silvain : "La biodiversité est un tout, il faut en étudier tous les composants, aussi bien ordinaires qu’extraordinaires, utiles ou nuisibles"
Rédigé par Modifié le
La Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) a organisé les 14-15 décembre 2011 un colloque de restitution de 17 projets financés par la FRB (IFB), le CNRS et l’AIRD en 2007. Ce colloque comportait quatre sessions : une consacrée à l’analyse de la biodiversité, une au fonctionnement des écosystèmes et services écosystémiques, une autre à la conservation et la gestion durable de la biodiversité, et enfin la dernière à l’écologie de la santé humaine, animale et végétale. Le Président du Conseil scientifique de la FRB, Jean-François Silvain, entomologiste et Directeur de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) a conclu cette dernière session. Il nous en livre le bilan.
La FRB a récemment consacré un colloque à la biodiversité des îles de l’océan Indien, que recouvre le terme de « biodiversité » ?
Jean-François Silvain : Il y a peu, un chercheur se demandait si les moustiques devaient être pris en compte dans la biodiversité amazonienne … étonnante question ! En effet, que ce soit en Amazonie ou dans les îles de l’océan Indien, les moustiques ou les phlébotomes, les virus ou les mauvaises herbes, en résumé les vecteurs de maladies, les parasites et les agents infectieux font partie intégrante de la biodiversité de par leur existence et les interactions, souvent extraordinairement complexes, qu’ils développent avec d’autres organismes. Composants de la biodiversité ordinaire, ils sont des acteurs du fonctionnement des écosystèmes qui les abritent et leur nuisibilité n’existe que dans le regard de l’espèce humaine, ce qui du point de vue de cette dernière est bien sûr justifié dans un contexte agronomique, sanitaire ou vétérinaire donné.
La biodiversité est un tout et elle ne fournit pas toujours les services écologiques sur lesquels beaucoup de scientifiques s’appuient pour en justifier la préservation. En parallèle à la biodiversité perçue comme patrimoniale ou utile qu’il faut mieux préserver, gérer et valoriser, il convient aussi de mieux gérer cette biodiversité nuisible ou négative en maximisant si possible au niveau local les services que d’autres composants de la biodiversité peuvent fournir, comme par exemple les agents de lutte biologique, de manière à réduire les intrants, en particulier chimiques, dans les itinéraires culturaux ou les pratiques de lutte, une nécessité tant au Sud qu’au Nord.
Vous avez conclu la dernière session du colloque, sur l'écologie de la santé humaine, animale et végétale. Que peut-on en retenir ?
J-F. S. : Les différents projets exposés au cours de cette session ont souligné l’importance de partenariats scientifiques à bénéfice mutuel lorsqu’il s’agit de mieux connaître les acteurs en jeux et leurs interactions (ici parasites, vecteurs, agents pathogènes, réservoirs animaux et sociétés humaines) et mieux gérer les conséquences d’une biodiversité nuisible ou négative dans les pays du Sud.
Le travail coordonné par Robin Duponnois et collaborateurs sur la lutte contre l’hémiparasite végétal Striga asiatica illustre bien l’intérêt d’une telle démarche. L’objectif est en effet de mobiliser un ensemble de pratiques agronomiques et de facteurs abiotiques ou biotiques, en particulier la microflore, les bactéries du sol ou encore les plantes pièges, susceptibles de réduire l’incidence du parasite. Cette approche intégrative et multiforme, qui relève de l’ingénierie écologique, n’est bien sûr possible que si l’on connaît très bien les différents acteurs des interactions que l’on veut favoriser, leur biologie et leur écologie. On notera au passage que Striga asiatica, comme de très nombreux pathogènes ou ravageurs, est une plante envahissante à Madagascar.
Ce caractère envahissant est partagé par l’agent de la panachure jaune du riz à Madagascar, le virus RYMV étudié par Denis Fargette et collaborateurs. L’objectif est ici d’étudier la dynamique micro-évolutive de cet agent infectieux dans un milieu insulaire récemment envahi, dans le but de mieux comprendre les conditions d’émergence et de propagation d’une telle maladie. En s’appuyant sur des approches épidémiologique et phytopathologiques, l’équipe a pu dater l’introduction et retracer l’histoire de sa propagation, un thème de recherche et un objectif commun à beaucoup d’équipes qui travaillent sur les espèces invasives. Un point important que j’ai noté est l’incidence indirecte de l’apparition de cette maladie sur la déforestation à Madagascar, et donc biensûr sur la flore et la faune, via son incidence directe sur la culture rizicole traditionnelle.
Quels sont les autres travaux qui ont été présentés durant cette session ?
J-F. S. : Le travail de Patrick Mavingui et de ses collaborateurs nous a fait quitter les pathogènes et parasites des cultures pour aborder la question des vecteurs de maladies humaines et animales sans délaisser toutefois les virus. Au delà de l’inventaire des moustiques vecteurs de ces maladies et de l’étude de leur prévalence et de la dynamique de leur répartition, l’originalité de cette étude repose en particulier sur la recherche de possibles interactions entre communautés microbiennes symbiotiques hébergées par les vecteurs (notamment les Wolbachia) et capacité vectrice des virus par les moustiques hôtes. Les résultats obtenus, publiés notamment dans Molecular Ecology, suggèrent que les Wolbachia pourraient réguler la réplication virale chez l’espèce vectrice, ce qui souligne à nouveau le caractère incontournable de la compréhension des interactions biologiques à l’échelle des individus, des espèces et des communautés si l’on veut mieux gérer, préserver, utiliser la biodiversité (je pense aux insectes parasitoïdes dont la spécificité d’hôte et la virulence met aussi en jeux Wolbachia et virus) ou ici lutter contre des vecteurs.
Avec Phlebemos, coordonné par Vincent Robert, nous sommes restés dans le domaine de la vection de maladies par les diptères, ici moustiques et phlébotomes, mais, au travers de l’inventaire, de la systématique et de la biogéographie de ces vecteurs, nous sommes retournés dans l’acquisition des données descriptives indispensables à toute étude ultérieure des processus à l’origine de la nuisibilité de ces insectes. La découverte par cette équipe de plusieurs espèces nouvelles pour la science dans des groupes taxonomiques pourtant très étudiés et parmi les mieux connus me donne l’occasion d’insister sur le caractère encore beaucoup trop parcellaire de la connaissance de la diversité des composants de la biodiversité, notamment dans la zone intertropicale, et en particulier pour des groupes taxonomiques non emblématiques.
A ce niveau, la poursuite d’un effort de formation de taxonomistes (systématiciens) dans cette zone géographique et plus généralement en Afrique reste un impératif à court et moyen terme. Il est évident que ces systématiciens doivent être formés à l’ensemble des techniques d’investigation aujourd’hui disponibles et qui sont garantes d’une connaissance plus précise et plus rapide de la diversité biologique.
Interview réalisée à partir du discours prononcé par Jean-François Silvain en clôture de la session « Ecologie de la santé humaine, animale et végétale » du colloque FRB « La biodiversité des îles de l’océan Indien » des 14-15 décembre 2011.